Entretien périodique - le jeudi 12 juillet à 17 h HAE
Nous prévoyons que la mise à jour prendra une heure. Le site Web sera inaccessible pendant cette période.
Le CCHST produit une vaste gamme de publications traitant de la santé et de la sécurité au travail. Chacune de ces publications est révisée par des experts représentant les gouvernements, les employeurs et les travailleurs afin de garantir l'exactitude technique et la lisibilité de son contenu. Pour en savoir davantage, consultez notre foire aux questions (FAQ).



















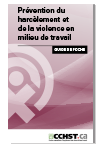
















Épargnez avec une remise sur quantité! Plus vous en achetez, plus vous économisez. Des réductions s’appliquent aux achats combinés de publications imprimées et de publications PDF effectués en une seule transaction. Veuillez noter que seuls certains titres sont offerts en version imprimée.
Le CCHST offre les remises ci-après aux acheteurs qui commandent un grand nombre d’exemplaires de la même publication. Les remises sont établies en fonction du prix individuel de la publication unique, auquel sont appliquées les remises multiples qui suivent :
| Quantité | Remise |
|---|---|
| 100-499 | 15 % |
| 500-999 | 20 % |
| 1000+ | 25 % |